 Cet été, Sidonis Calysta et Seven 7 proposaient une nouvelle salve de westerns, et que des bons. Pour ne pas gâter le palais des fins connaisseurs de l’Amérique cruelle et sauvage, l’idée merveilleuse du fil rouge s’imposait. La cohérence entre les œuvres est là, et bien là. Les films, tournés à 25 ans d’intervalle, se répondent. Nous qualifierons cette sélection de « tranchante, tendue, limite borderline ». Au menu des réjouissances ; un ancien confédéré utopique, un repenti sur la voie de l’expiation, un shérif revanchard, un garde frontalier méprisé, un super salaud vraiment… Bref, que des petits gars qu’en ont gros sur la patate ! Pour la faire courte, nous sommes loin des westerns à papa où les cow-boys et les Indiens semblent sortir tout droit de Chez Castel. Et bientôt la collection automne/hiver des vachers en folie. Affaire à suivre…
Cet été, Sidonis Calysta et Seven 7 proposaient une nouvelle salve de westerns, et que des bons. Pour ne pas gâter le palais des fins connaisseurs de l’Amérique cruelle et sauvage, l’idée merveilleuse du fil rouge s’imposait. La cohérence entre les œuvres est là, et bien là. Les films, tournés à 25 ans d’intervalle, se répondent. Nous qualifierons cette sélection de « tranchante, tendue, limite borderline ». Au menu des réjouissances ; un ancien confédéré utopique, un repenti sur la voie de l’expiation, un shérif revanchard, un garde frontalier méprisé, un super salaud vraiment… Bref, que des petits gars qu’en ont gros sur la patate ! Pour la faire courte, nous sommes loin des westerns à papa où les cow-boys et les Indiens semblent sortir tout droit de Chez Castel. Et bientôt la collection automne/hiver des vachers en folie. Affaire à suivre…
 La Ruée sauvage, de James P. Hogan avec Randolph Scott, Joan Bennett, May Robson…
La Ruée sauvage, de James P. Hogan avec Randolph Scott, Joan Bennett, May Robson…
Un ancien soldat de l’armée confédérée reconverti en éleveur de bétail affronte de nouveaux ennemis ; les opportunistes, les usurpateurs ; ceux qui, sur le dos des petites gens, s’enrichissent, quand la nation fragile et convalescente essaie de se relever du chaos. La Ruée sauvage traite de la période post-Sécession, où les têtes pensantes de l’Amérique trop affairées à s’octroyer des privilèges pour les siècles à venir ont laissé des hommes de peu de vertu faire leurs lois. Cette page de l’histoire américaine est passionnante à plus d’un titre parce qu’elle présente les héros désignés sous leur vrai visage ; lesquels profiteront du désordre, lesquels choisiront la voie du partage et de l’entraide. C’est à nous de reconnaître les justes, les sincères humanistes. Un western rigoureux.
 La Cible humaine, d’Henry King avec Gregory Peck, Helen Wescott, Millard Mitchell…
La Cible humaine, d’Henry King avec Gregory Peck, Helen Wescott, Millard Mitchell…
La Cible humaine d’Henry King est l’une de ces merveilles que l’on croise une fois l’an. Un rythme exemplaire, une interprétation au cordeau, une mise en scène chiadée. La Cible humaine raconte les derniers jours d’une crapule notoire, Jimmie Ringo. Las des défis, las de fuir et de bourlinguer, Ringo ne pense qu’à raccrocher les éperons pour mettre un terme à sa foutue vie de brigand. Revoir sa famille qu’il a laissée choir comme une crotte, voilà ce qui l’obsède. Mais Ringo ne cesse d’être la cible des cow-boys de pacotille. Dans les saloons et les sombres ruelles, sa notoriété lui cause bien des soucis. Le film accroche dès les premières minutes. Gregory Peck, en salaud repenti moustachu, donne à cette tragédie toute sa puissance. L’empathie fonctionne. Nous vivons les regrets, les remords, le sentiment d’une vie gâchée. Western très recommandé.
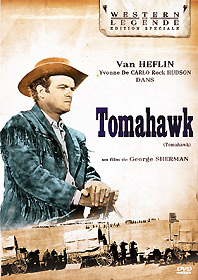 Tomahawk, de George Sherman avec Van Heflin, Yvonne de Carlo, Rock Hudson…
Tomahawk, de George Sherman avec Van Heflin, Yvonne de Carlo, Rock Hudson…
Tomahawk ne fait pas dans l’originalité : ruée vers l’or, tribus indiennes spoliées de leurs terres, médiateur du gouvernement trompé et manipulé. Van Heflin joue le garde frontalier Bridger. Marié à une Sioux, il a le cul coincé entre deux tipis (suspect aux yeux des Peaux-Rouges et des visages pâles ; c’est tout l’inconvénient du couple mixte !) ; pas facile de pacifier une région quand le moindre conflit se règle à coups de fusil. Les projets du gouvernement ne rassurent pas le pauvre Bridger ; pour preuve, la nouvelle route commerciale profane le territoire sacré des Sioux. La faute à ce foutu métal jaune qui aiguise les appétits en même temps qu’il attire son cortège d’affreux aventuriers. C’est l’histoire de l’Amérique dans toute sa complexité. La réalisation de George Sherman ne transcende pas le genre mais le film se suit avec plaisir. Il donne un goût de reviens-y comme la poire William au pépé.
 Les Aventures de Robinson Crusoé et Une femme sans amour de Luis Bunuel
Les Aventures de Robinson Crusoé et Une femme sans amour de Luis Bunuel
Un film d’aventure signé Luis Bunuel. Intitulé Les Aventures de Robinson Crusoé. bof, quoi ! C’est sans compter sur le savoir-faire du Maître. Bonne pioche que cette adaptation de l’œuvre de Daniel Defoe ! Bunuel a saisi à bras le corps les grands thèmes du roman que sont la solitude, la foi, la fraternité, le respect de l’autre… L’empreinte du grand est reconnaissable car rien ne tombe tout cuit dans la gamelle du naufragé. J’appelle ça de l’écriture bien placée ! Nous voyons Robinson renaître, grandir, s’éduquer, redevenir un homme. Seul. Le scénario insiste sur les capacités du héros à s’adapter, appréhender et contrôler son nouveau milieu. Bunuel ne l’aide pas, ne joue pas au démiurge. Il lui offre une nouvelle chance.
Une femme sans amour est l’adaptation « très » réussie de Pierre et Jean, quatrième roman de Guy de Maupassant. Bunuel filme les mensonges et les faux semblants avec le tact qui le caractérise ; les silences et les regards amenés sans hystérie. Le temps décompose les secrets familiaux. Une œuvre somme.
 Le Tueur au visage d’ange, de Gordon Douglas avec Robert Evans, Hugh O’Brian, Linda Cristal…
Le Tueur au visage d’ange, de Gordon Douglas avec Robert Evans, Hugh O’Brian, Linda Cristal…
Le Tueur au visage d’ange, remake du Carrefour de la mort réalisé par Henry Hathaway en 1947, est un petit chef-d’œuvre de noirceur. Je n’y vais pas par quatre chemins, mon sens de l’orientation reste problématique. Gordon Douglas a goupillé un western angoissant aux limites du thriller. Le Tueur au visage d’ange ne s’inscrit pas dans le tout-venant du genre. Robert Evans (oui, « le » Bob Evans ; « le » consommateur de blondes à forte poitrine, « la » légende d’Hollywood, « le » producteur de Coppola et Polanski…) incarne le sale gosse imprévisible, un parasite qui, lentement, vous grignote et bousille votre vie. Les critiques de l’époque, toutes myopes des yeux, myopes du cœur et myopes du cul, le trouvaient falot. Les mécréants ! Son visage mêle les traits du jeune homme mal dégrossi et ceux du psychopathe. Oublions l’idée de l’appeler « L’ange noir », sobriquet un peu trop classieux pour ce petit merdeux. Surtout, il est la teigne Felix Griffin et le problème de Daniel Hardy (Hugh O’Brian), compagnon de cellule, brigand au grand cœur enfin décidé à emprunter le sentier du repentir. Problème : ce dernier a confié un secret à Griffin qui s’apprête à sortir de prison. Libre, Griffin fait régner la terreur dans l’entourage proche d’Hardy. Les autorités locales, acculées et impuissantes, décident de lâcher Hardy aux trousses de Griffin. L’énergie du scénario tient aux relations complexes entre les personnages. Griffin se rêve en caïd tandis qu’Hardy combat ses vieux démons. L’affrontement des rivaux tient toutes ses promesses. La vengeance, la peur, la contrainte et l’humiliation composent le réjouissant menu de ce western majeur.
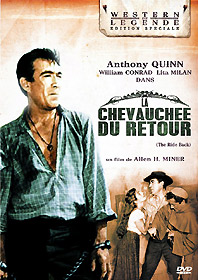 La Chevauchée du retour, d’Allan H. Miner avec Anthony Quinn, William Conrad, Lita Milan…
La Chevauchée du retour, d’Allan H. Miner avec Anthony Quinn, William Conrad, Lita Milan…
La Chevauchée du retour n’a rien du périple gigantesque à la John Ford mais tout du voyage intime entre un shérif et son prisonnier. Chris Hamish, représentant de la loi, passe pour le loser de service. Chez lui, on ne lui prête que des échecs, on ne lui offre que la raillerie. Ses supérieurs le chargent de ramener le criminel Bob Kallen du Mexique jusqu’aux Etats-Unis afin de le juger. L’aventure n’est pas sans repos ; le caractère bien trempé de Kallen use la patience d’Hamish. Les Indiens harcèlent les deux hommes qui coopèrent contraints et forcés. Des liens d’amitié se nouent dans l’adversité. Même s’il ne laisse rien transparaître, Hamish cache une secrète admiration pour son prisonnier. La bonhomie d’un Conrad revanchard s’oppose à la minéralité d’un Quinn qui va en s’humanisant.
 Le Raid, d’Hugo Fregonese avec Van Heflin, Lee Marvin, Richard Boone, Peter Graves, Anne Bancroft…
Le Raid, d’Hugo Fregonese avec Van Heflin, Lee Marvin, Richard Boone, Peter Graves, Anne Bancroft…
Le Raid traite de politique et de posture morale ; sujets ambitieux pour western appliqué. Comme l’explique très justement Bertrand Tavernier dans les bonus, les soldats confédérés (le Sud) ont toujours été désignés par le cinéma américain comme les gauchistes de service (reste à savoir, mais cette question pourrait faire l’objet d’un dossier tout entier, si « gauchistes » se traduit par bouseux, ploucs, lâches ou lopettes…) et les nordistes comme une entité soldatesque déjà bien ancrée dans la mouvance « droite républicaine » (les courageux, les instruits, les cow-boys propres). Toutefois, considérer aveuglément les sudistes comme plus humanistes que les nordistes, tout en stigmatisant les nordistes comme de fieffés salauds, c’est aller un peu vite en besogne. -Nous sommes cernés par les cons ! disait… mais qui… je ne sais plus, un officier sans doute…Le Raid raconte l’évasion d’une troupe de confédérés qui a pour mission d’incendier une ville nordiste. Le chef tisse des liens avec la population et s’amourache d’une ravissante veuve et son fils. Mais la funeste mission s’accomplit. Triste. Snif.
Quoi de mieux pour dénoncer l’absurdité de la guerre qu’une aussi folle entreprise ? Le Raid nous prend à témoin (l’événement est historiquement vrai !) que l’honneur mal placé conduit à la désolation et à la mort. Van Heflin endosse le rôle du soldat embarrassé entre lâcheté et rédemption pendant que Lee Marvin, avec sa gueule de chien galeux, s’enfonce dans l’idée de châtier coûte que coûte les habitants. Pour l’exemple, par pure vengeance. Crimes et châtiments, ils ont choisi leur camp, les camarades.
 C’est arrivé entre midi et trois heures de Franck D. Gilroy, avec Charles Bronson, Jill Ireland…
C’est arrivé entre midi et trois heures de Franck D. Gilroy, avec Charles Bronson, Jill Ireland…
Mais quel drôle de film, quel drôle de western, quelle drôle d’histoire ! Impossible de vous déflorer l’intrigue. Sachez que Terry Gilliam ou les frères Coen n’auraient pas dépareillé aux manettes de From Noon Till There. Plantons le décor ; une maison de maître dans le désert, une jolie veuve bien barrée, un lâche brigand, une légende bâtie sur le mensonge. Et le tout donne des scènes entre rêve et réalité. Jill Ireland et Charles Bronson campent deux magnifiques mystificateurs. Une très belle redécouverte.
